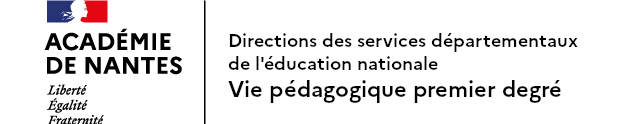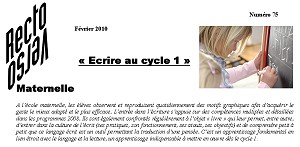Vous êtes ici : Maine-et-Loire » Année 2010 » n°75 : Écrire au cycle 1
n°75 : Écrire au cycle 1
A l'école maternelle, les élèves observent et reproduisent quotidiennement des motifs graphiques afin d'acquérir le geste le mieux adapté et le plus efficace. L'entrée dans l'écriture s'appuie sur des compétences multiples et détaillées dans les programmes 2008. Ils sont également confrontés régulièrement à l'objet « livre » qui leur permet, entre autre, d'entrer dans la culture de l'écrit (ses pratiques, son fonctionnement, ses atouts, ses objectifs) et de comprendre petit à petit que ce langage écrit est un outil permettant la traduction d'une pensée. C'est un apprentissage fondamental en lien étroit avec le langage et la lecture, un apprentissage indispensable à mettre en œuvre dès le cycle 1.
1. Trois activités pour une même gestualité
- Les activités graphiques * La dominante est graphique.
Elles se déterminent à partir de consignes sur les lignes, les couleurs, les formes... Elles sont l'occasion de construire des comportements (analyse d'une forme, comparaison, mise en mémoire, reproduction, automatisation). En graphisme, l'adulte met en place des habiletés qui ne sont pas uniquement celles de l'écriture.
- Le dessin * La dominante est plastique.
Il est basé sur l'interprétation et la mise en forme, sur la représentation imaginaire et créative à partir d'un agencement personnel et expressif de lignes, de formes, de figures.
- L'écriture * La dominante est sémiotique (la sémiotique étant l'étude des pratiques signifiantes et prenant spécifiquement le texte comme domaine).
Elle consiste en une production de séquences linguistiques et signifiantes utilisant les règles du codage écrit. Ces activités fournissent un matériel important pour la construction du principe alphabétique.
Le travail d'écriture pour des élèves, en maternelle, représente un réel investissement qu'ils ne peuvent assurer sans le support d'une pédagogie solide et habilement menée.
L'enfant apprend à écrire en comprenant quel type de codage il utilise et pourquoi. Le tracé des capitales d'imprimerie est encouragé chez les plus jeunes, cette étape visant à l'autonomie dans l'utilisation d'un code. Le recours à l'écriture cursive est possible quand l'élève est capable de gérer un tracé continu, orienté, respectant les levers de crayon correspondant à la segmentation graphique. Pour cela, les enseignants doivent moduler leurs exigences et observer les élèves pour proposer un enseignement individualisé et progressif.
Pourquoi ?
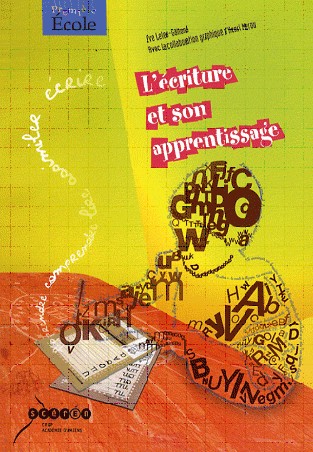 Dans son ouvrage « L'écriture et son apprentissage », Eve LELEU-GALLAND écrit page 62 : « Parce que pour écrire, il faut savoir établir une coordination entre un mouvement de translation et de cursivité et des mouvements de rotation qui exigent des freinages dans la cursivité. Ce sont des mouvements paradoxaux que l'enfant doit réussir à combiner ».
Dans son ouvrage « L'écriture et son apprentissage », Eve LELEU-GALLAND écrit page 62 : « Parce que pour écrire, il faut savoir établir une coordination entre un mouvement de translation et de cursivité et des mouvements de rotation qui exigent des freinages dans la cursivité. Ce sont des mouvements paradoxaux que l'enfant doit réussir à combiner ».
=> C'est possible si les appuis sont fermes : avant-bras en équilibre mais souplesse du mouvement à partir de l'articulation de la main.
=> C'est possible si le modèle à reproduire est parfaitement perçu par l'enfant.
=> C'est possible si l'enseignant décompose et recompose sous les yeux de l'enfant les étapes du mouvement, les trajectoires et les levers du crayon.
=> C'est possible si, après une phase d'entraînement et de mise en mémoire kinesthésique, le contrôle visuel prend le relais, chaque partie de l'acte devient alors le signal de la suivante.
2. Les pratiques pédagogiques
3. Le fonctionnement en ateliers
- L'atelier dirigé : il privilégie la construction d'un savoir. Le rôle de
 l'enseignant est de guider, d'aider à construire des gestes d'écriture en adéquation avec la norme fixée. Les interactions sont favorisées, la verbalisation de l'action est essentielle. Ecrire sous les yeux des élèves, parler de ce que l'on fait est un vrai travail de rapport au savoir qui s'installe.
l'enseignant est de guider, d'aider à construire des gestes d'écriture en adéquation avec la norme fixée. Les interactions sont favorisées, la verbalisation de l'action est essentielle. Ecrire sous les yeux des élèves, parler de ce que l'on fait est un vrai travail de rapport au savoir qui s'installe.
Pour travailler la cursive, l'élève doit être capable d'anticipation. Quand il trace la première lettre, il doit penser à la seconde. Cette planification est fondamentale et conditionne plus tard la production d'écrits au cycle 2. La mémoire joue un rôle essentiel dans la familiarisation et l'appropriation du code écrit.
- L'atelier accompagné (régulé souvent par l'ATSEM) : les activités proposées par l'enseignant permettent l'exercice d'une compétence déjà travaillée, sa consolidation par l'usage, son réinvestissement, son transfert à d'autres situations.
- L'atelier autonome : l'enfant y est capable de réaliser une tâche définie par une consigne précise sans accompagnement. Il peut s'entraîner à reproduire des motifs graphiques travaillés précédemment en atelier dirigé. Les aides sont à sa disposition (affichages, dictionnaires graphiques...).
- Les ateliers permanents : cette installation proposée à l'accueil ou sur des temps de transition entre deux situations permet des activités en autonomie mais dont les consignes sont claires avec un matériel de bonne qualité.
=> Un répertoire de formes (œuvres ethniques, broderies, mosaïques, photographies de l'environnement, papiers peints) est mis à la disposition des élèves. Il est possible de faire rechercher deux motifs sur une œuvre et de les reproduire.
=> Des anneaux, des allumettes, des clous cavaliers peuvent constituer une situation recherche intéressante. L'élève est invité à proposer une succession avec ces objets (de gauche à droite). Les traces sont photocopiées et constituent un prolongement motivant : reproduire avec de la pâte à modeler, un crayon HB, le motif créé.
=> Une boîte de mots connus par les élèves peut inciter à écrire un mot, une phrase qui font sens.
4. Quand aborder les situations de production d'écrit en maternelle ?
A ce stade les activités proposées en écriture inventée (faire verbaliser ce que les élèves veulent écrire, conduire le dialogue afin d'aboutir à une phrase ou un texte court en laissant l'enfant proposer une écriture qu'il recherchera dans les aides ou outils disponibles en classe et en n'apportant pas immédiatement la réponse) ou en dictée à l'adulte vont se transformer en situation de production d'écrit. Les enfants ont alors conscience de leur maîtrise partielle de l'écrit et ils vont pouvoir produire des textes plus conséquents.
Pour conclure, Mireille BRIGAUDIOT dans son ouvrage, « Apprentissages progressifs de l'écrit à l'école maternelle », met en avant que l'écriture ce n'est pas que de l'écriture, c'est du langage. Il s'agit d'une activité humaine complexe, d'ordre physique. Il faut que les enfants perçoivent ce rapport entre le dit et l'écrit : ces traces peuvent être transformées en langage par quelqu'un d'autre qui peut retrouver la pensée du premier (notion d'écrit en boucle). Quand le pouvoir de l'écrit est compris, l'enfant va avoir envie d'écrire, de lire des histoires. C'est bien cela qui est visé en fin de GS.
Bibliographie :
o « L'écriture et son apprentissage » E. Leleu-Galland (Ed. Sceren - 2008)
o « Apprendre à écrire de la PS à la MS » M.T Zerbato-Poudou (Ed. Retz - 2008)
o « Apprentissages progressifs de l'écrit en maternelle » M. Brigaudiot (Ed. Hachette Education - 2008)
P. PERRIER - IEN Angers 9 / F. LERAY (directrice d'école d'application)
L. Pallard